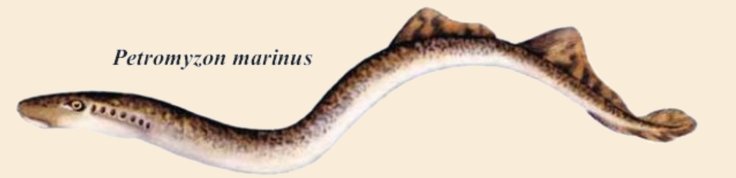J’entends ou je vois souvent cette question posée sur les médias sociaux ou sur les forums de pêche : « À quelle vitesse de traîne doit-on pêcher pour telle ou telle espèce? » Je pense que la réponse n’est pas aussi simple que la question!!! En fait, selon moi, la question est mal posée dans le sens où elle ne se base pas sur le bon postulat de départ.
Après plusieurs années de tests et d’expérimentations, il m’apparait clair que la vitesse de traîne ne se détermine pas en fonction d’une espèce donnée mais plutôt selon le type de leurre utilisé et en fonction de certains paramètres que je vais tenter de résumer ici.
– La présentation d’un leurre en fonction de son type et de son poids
Chaque leurre a une vitesse optimale de présentation. Cependant, certains types de leurre permettent un large éventail de vitesse possible, alors que d’autres ont une fenêtre de vitesse très limitée. Habituellement, plus le leurre est lourd, plus sa fenêtre de possibilité de vitesse va être étendue. Généralement, le point de démarcation entre une présentation optimale à la vitesse optimale pour un leurre donné est le moment ou ce leurre perd son pouvoir attractif en devenant inactif ou en décrivant des mouvements trop erratiques et non naturels.

Conseil :
Pour trouver la vitesse optimale de présentation d’un leurre, installez votre leurre au bout de votre canne et mettez le dans l’eau à côté de votre embarcation, il faut que le leurre soit complètement submergé, ensuite, essayez différentes vitesses de traîne et vous pourrez ainsi observer les différents mouvements de votre leurre en fonction des différentes vitesses.
– La température de l’eau et la température préférentielle de l’espèce visée
Certains leurres qui ont un éventail plus large de vitesse peuvent donc être utilisés à différentes vitesses de traîne. C’est avec ce type de leurres qu’entre en ligne de compte un autre paramètre qu’est la température de l’eau versus la température préférentielle de l’espèce pêchée. En effet, il faut savoir que la température de l’eau va jouer sur la « volonté » de l’espèce visée à attaquer vos leurres ou non et ce même si la présentation de votre leurre n’est pas optimale en termes de vitesse.

Conseil :
Recherchez la profondeur ou se situe la température préférentielle de l’espèce visée et présentez vos leurres dans cette zone de profondeur en variant votre vitesse de traîne. Vous pouvez utiliser votre embarcation pour décrire des « S » ce qui fera augmenter la vitesse de présentation d’un leurre situé sur un côté du bateau et diminuer la vitesse du leurre présenté sur l’autre côté de l’embarcation.
– Les conditions météorologiques, climatiques et saisonnières en fonction de l’activité du poisson et de son régime alimentaire
Il est indéniable que certaines conditions météorologiques momentanées, certaines conditions climatiques ponctuelles ou encore certaines conditions saisonnières récurrentes peuvent jouer un rôle important sur « l’humeur » du poisson. Il devient donc important d’ajuster la vitesse de présentation de vos leurres en fonction des ces conditions. Ainsi, vous ne pêcherez pas à la même vitesse de traîne avec le même leurre en été à forte profondeur que durant le printemps ou l’automne à faible profondeur. Il faut aussi considérer l’activité du poisson et sa concentration non seulement en fonction du temps de la journée mais aussi en fonction du temps de l’année.
De façon générale, je dirai que plus l’espèce ciblée est profonde et/ou dispersée, plus il est important de bien contrôler sa présentation et d’utiliser des leurres à faible éventail de vitesse. Dans ces conditions, il devient important de reproduire le plus fidèlement possible le comportement et l’action naturelle de ce que votre leurre imite. Cela permet d’ajouter une dimension supplémentaire à la perspective de proposer de la nourriture à l’espèce visée, c’est aussi de provoquer chez elle un réflexe d’instinct mémoriel de prédation et d’alimentation, une dimension « aguicheuse » et « séductrice » qui pourrait tenter l’espèce visée même si celle-ci n’est pas en mode de recherche alimentaire.
À l’inverse, lorsque l’espèce visée est active et/ou en forte concentration sur une faible superficie elle est alors en période de frénésie alimentaire et elle se retrouve souvent en compétition directe pour la nourriture. Dans ce cas, il vaut mieux présenter des leurres avec un plus grand éventail de vitesse de traîne et pêcher plus vite pour diminuer le temps de réaction et de « réflexion » de l’espèce ciblée. Il n’est plus question de chercher à effectuer une présentation subtile, il faut travailler avec des leurres voyants et bruyants à vitesse maximale et optimale de vos leurres pour ajouter à votre présentation une dimension agressive qui peut réveiller un réflexe inné de compétition alimentaire et un instinct « d’exaspération » et de prédation de la part de l’espèce visée.

Conseils :
Avant une sortie de pêche, vérifiez des paramètres tels que pression atmosphérique prévue versus pression atmosphérique de la veille, variations de température de l’air durant la journée, luminosité et alternance soleil-nuage, tables solunaires avec périodes majeures et mineures pour les grands plans d’eau, période de frénésie alimentaire en fonction de l’espèce visée.
Pendant la sortie de pêche, sachez vous adaptez rapidement en fonction de l’activité et de « l’humeur » du poisson. Variez vos vitesses de présentations avec des leurres à large éventail de vitesse de traîne ou alors précisez votre présentation avec des leurres à faible éventail de vitesse de traîne.

En conclusion, je reviendrai avec le fait qu’il n’y a pas de recettes spécifiques et miraculeuses pour la vitesse de traîne mais il faut savoir garder en tête un ensemble de paramètres importants, rester alerte et attentif afin de les combiner en fonction des conditions de la journée et des observations faites sur le moment et s’imposer une rigueur dans la préparation et la documentation sur l’espèce visée et sur le plan d’eau choisi.
En espérant que cet article vous sera utile pour votre prochaine saison de pêche afin que celle-ci soit remplie de nouvelles expériences enrichissantes et de belles captures.
Écrit par :
Bruno Mayot
Lomechuse guide de pêche aux salmonidés
Lac Memphrémagog (été – hiver)
Rivières du lac Ontario (automne – printemps)
819-209-5633
www.lomechuse.com
info@lomechuse.com